Dans le cadre de sa thèse, le sociologue Joël Vacherona décortiqué les images de la Terre et du Cosmos produites par les programmes spatiaux des grandes puissances. Il y a notamment découvert l’empreinte des conquêtes coloniales qui ont façonné le monde à leur image.
TEXTE | Marco Danesi
La Terre est-elle vraiment bleue, comme elle apparaît sur la photo « The Blue Marble » prise par l’équipage d’Apollo 17 le 7 décembre 1972, en route vers la Lune ? La question n’a rien decomplotiste. Au contraire : elle alimente en filigrane le travail du sociologue Joël Vacheron. Dans le cadre de sa thèse de doctorat, cet enseignant et chercheur à l’ECAL / École cantonale d’art de Lausanne – HES-SO s’est intéressé aux représentations du Cosmos et de la Terre pour les regarder autrement. Non plus comme des reproductions objectives et neutres, mais comme des visions véhiculant « des points de vue qui, malgré leur prétention à une inclusivité totale, appartiennent à des cultures visuelles qui n’ont pas toujours été universellement partagées ». En un mot, il propose de les « déregarder » pour démasquer leur « provincialisme ». Son travail a fait l’objet d’un ouvrage publié en 2025, Cosmovisions, une étude visuelle des fondements coloniaux de l’exploration spatiale.
Valoriser des contre-récits
Mais qu’est-ce que « déregarder ? » Le verbe – traduction de l’anglais unsee – suggère la volonté de rendre apparente la dimension coloniale de ces images fabriquées et diffusées dans le cadre de l’exploration de l’espace, de les questionner, voire de les prendre au piège. Joël Vacheron cite l’exemple de la une du Daily News du 31 mai 2020, qui plaçait côte à côte une photo des manifestations contre le racisme antinoir aux États-Unis et une image de la fusée du programme Launch America de la NASA (qui vise à envoyer des astronautes vers la Station spatiale internationale, ndlr) : « Elle offrait un prisme puissant pour “déregarder” les récits héroïques » de la conquête de l’espace.
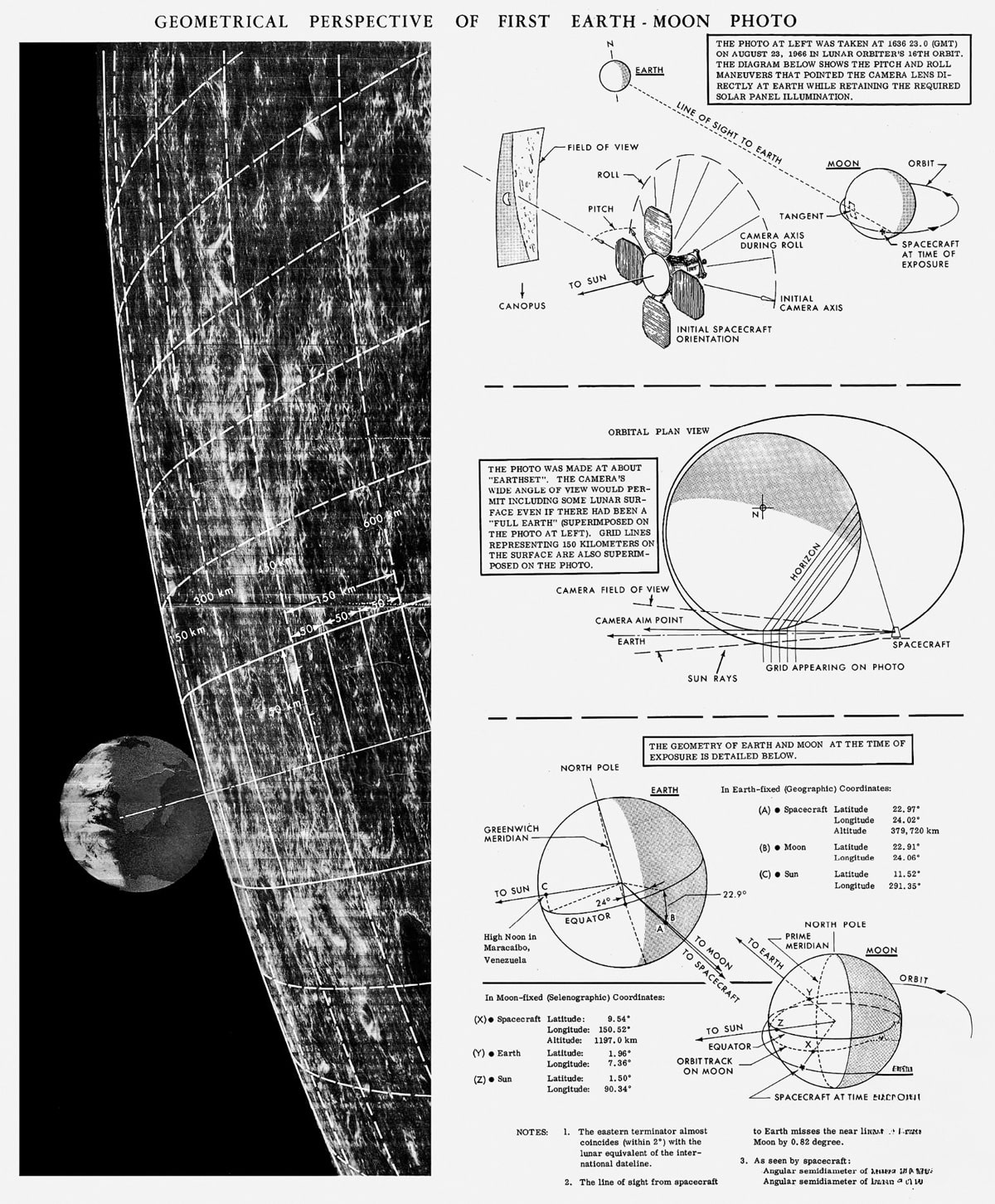


Inspiré par l’étude des « cultures visuelles », l’auteur mentionne, en guise de précurseurs, John Berger ou Roland Barthes et leurs essais critiques de l’imagerie populaire réalisés au cours des années 1960/1970. Il cite également Nicholas Mirzoeff, théoricien de la culture visuelle et professeur à l’Université de New York. Ce dernier a montré, notamment à partir d’une toile du fondateur du mouvement impressionniste Claude Monet – Impression, soleil levant (1873) – la nécessité de dévoiler ce qui a été rendu invisible par « nos manières de voir » le monde. Selon cet activiste visuel, le tableau en question – chef-d’œuvre mondialement reconnu saisissant les fumées qui flottent au-dessus du port normand du Havre– peut être considéré, au-delà de ses qualités esthétiques, comme un témoignage des conséquences destructrices de la révolution industrielle. « Les images du Cosmos et de notre planète, issues de l’expansionnisme spatial, méritent le même traitement », avance Joël Vacheron.
De Magellan à SpaceX
Sa thèse suit deux pistes. La première pointe du doigt une cosmovision tout droit sortie de la Guerre froide sur le modèle colonial. Au moment de la décolonisation, les images prises par les astronautes ou par les satellites sont destinées à rendre objective la vision historiquement située du monde et de l’Univers propre au programme spatial américain, mis à mal par l’Union soviétique. La deuxième piste passe au crible l’exploration spatiale états-unienne, « mission planétaire qui se voulait coopérative et pacifique, lancée au nom de toute l’humanité ». Joël Vacheron souligne, dans cette optique, que « les acteurs de la conquête spatiale (hier la NASA, aujourd’hui SpaceX, ndlr) continuent d’envisager cette mission comme une nécessité » à la fois économique et altruiste. Il s’agit d’entretenir un secteur qui brasse des sommes d’argent énormes avec le prétexte de sauver la planète et les humains, même malgré eux, s’il le faut.
Que ce soient des photos argentiques ou des artefacts numériques, les images sont communiquées et perçues à l’instar « des documents présentant l’expansionnisme comme une mission fondamentalement humaine, note encore Joël Vacheron. Elles naturalisent les fondations coloniales sur lesquelles s’est bâti le capitalisme marchand. » De nos jours, les cosmovisions « totalitaires des barons de l’espace tels qu’Elon Musk ou Jeff Bezos » illustrent parfaitement ce tour de passe-passe. Ces visions, que Joël Vacheron assimile à des hallucinations, spéculent sur un avenir multiplanétaire, du moins extraterrestre, pour l’humanité en danger. Grâce aux progrès techniques, Mars ou les habitats spatiaux pourraient se transformer en Terre de substitution. Sauf que, remarque le sociologue, l’embarquement vers cette nouvelle frontière, qui rejoue les Grandes Découvertes ou la conquête de l’Ouest, tournerait à l’avantage d’une élite fortunée qui se cache derrière un « nous » de façade. Ce pseudo-universalisme abandonne à leur triste sort les autres, « ceux qui peuplent les cales de la modernité ». Bref, la nouvelle arche de Noé ne serait en réalité pas accessible à tout le monde.

Les schémas de la nouvelle économie spatiale
Pour sortir de cette impasse, et échapper à l’emprise de ces cosmologies globalisées mêlant gros sous, technosolutionnisme et et surveillance généralisée, Joël Vacheron mise sur des « cosmologies pluriverselles » et non pas universelles, seules susceptibles « de troubler les schémas manichéens de la nouvelle économie spatiale ».Il est donc temps « de révéler les bruits et les craquements dans l’espace lisse de cette dernière et de son imaginaire aliénant ». Mais comment désorganiser ces savoirs institués ? En démontant les rouages de la manipulation à la fois formelle et idéologique de cette iconographie qui se veut planétaire au moyen d’un corpus visuel éloquent, répond le sociologue. On découvre alors que les affiches vantant des visites touristiques virtuelles d’exoplanètes proposées par une agence fictive imaginée par la NASA, parmi tant d’autres échantillons, sont directement inspirées des campagnes publicitaires des années 1940, caractérisées par leur empreinte coloniale, qui faisaient la promotion de parcs nationaux sur des territoires autrefois occupés par des populations amérindiennes.
Avec une visée critique, sinon militante, Joël Vacheron interroge « certaines vérités universelles–civilisation, progrès, modernisation ou libéralisme – véhiculées à travers les images spatiales, afin de (re)valoriser des visions du monde multiples émanant de communautés marginalisées ou invisibilisées ». Pour ce faire, il s’agit d’adopter une méthodologie « rebelle », selon le terme proposé par Katherine McKittrick, professeure canadienne en études de genre, qui participe à déconstruire les hiérarchies traditionnelles du savoir. Cette dernière recommande des pratiques à contre-courant, observées au sein de communautés afrodescendantes avec des « productions artistiques ou intellectuelles qui insistent sur l’importance de créer des récits déstabilisant les systèmes de connaissance dominants : inventer avec des objets trouvés, inverser les scénarios, apprendre à parler avec de nouvelles formules, etc. ».Rammellzee, graffeur new-yorkais proche de l’artiste afro-américain Jean-Michel Basquiat, représente un bon exemple de ces pratiques rebelles. Il avait en effet créé « sa propre Guerre des étoiles » (contrepoint au projet reaganien de bouclier spatial contre les missiles nucléaires ennemis) : « un univers de bric et de broc habité par des formules obscures, des lettrages incompréhensibles qui minent l’évidence de visions officielles en libérant l’alphabet et en renversant l’ordre des signes ».
En guise de conclusion, mais aussi d’ouverture vertigineuse, Joël Vacheron esquisse une perspective dépassant le regard, voire l’acte critique de « déregarder ». Il invite à « écouter les images », suivant la méthodologie développée par Tina Campt, théoricienne féministe noire, qui se focalise sur leur impact acoustique laissant entrevoir « une possible perception du Cosmos au-delà de la vision ».
Quant à The Blue Marble, donnait-elle à voir la Terre telle qu’elle était ou plutôt telle que la NASA voulait la donner à voir ? Était-elle vraiment bleue ou pas ? La réponse est double. C’est bel et bien une photo de la planète prise par l’un des astronautes de la mission Apollo 17. Mais l’image a été retournée pour correspondre aux habitudes visuelles associées aux mappemondes en valorisant la couleur bleue. La Terre devenait ainsi un lieu désirable et à protéger par dessus les frontières, au moment où l’Occident commençait à s’inquiéter pour l’avenir de la planète et de l’humanité.

