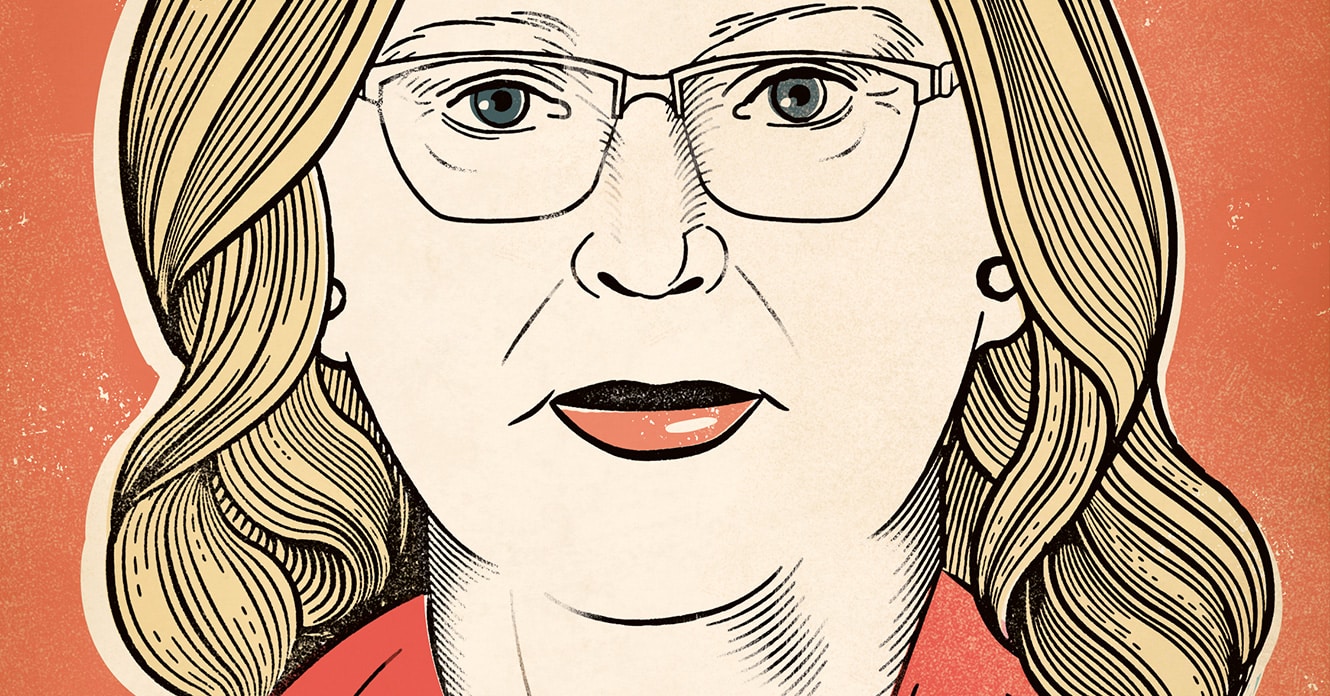La Convention du patrimoine mondial a été établie il y a près de 50 ans. À quoi ressemblent maintenant ce patrimoine, sa protection et les menaces qui pèsent sur lui ? Les réponses de Mechtild Rössler, directrice du Centre du patrimoine mondial de l’Unesco.
TEXTE | Nic Ulmi
ILLUSTRATION | Susan Burghart
Par-delà ses déchirements guerriers et ses égarements environnementaux, l’humanité possède un patrimoine commun, fait de nature et de culture, dont la communauté mondiale des États est la gardienne. Affirmé par la Société des Nations dans les années 1920, incarné au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par l’Unesco (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture), ce principe fonde la Convention du patrimoine mondial, établie en 1972. Si ses textes n’ont pas évolué, leur interprétation s’est modifiée en presque cinq décennies. Tout comme les menaces, de plus en plus intenses, qui planent sur les quelque 1121 sites protégés. Le travail que représente leur préservation est devenu titanesque, mais n’est pas toujours pris au sérieux, explique Mechtild Rössler, directrice du Centre du patrimoine mondial de l’Unesco.
Les forêts hyrcaniennes en Iran, les collines du Prosecco en Italie, la mine de charbon d’Ombilin en Indonésie… Ce sont trois des «nouveaux biens» inscrits en 2019 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, qui compte aujourd’hui 1121 entrées. Qu’ont-ils en commun?
Les trois biens que vous avez choisis sont respectivement un «site naturel», un «site culturel» et un «paysage culturel», selon notre terminologie. Ce sont trois exemples de l’idée formulée dans les articles 1 et 2 de la Convention du patrimoine mondial: identifier des sites d’une valeur universelle exceptionnelle et affirmer que la totalité de l’humanité a la responsabilité de les préserver. La diversité entre ces trois genres de sites témoigne, quant à elle, de l’évolution du concept de patrimoine par rapport à sa signification ancienne, qui était centrée sur le bâti: les pyramides égyptiennes, la cathédrale de Chartres, le Taj Mahal… Aujourd’hui, la notion de patrimoine englobe des biens témoignant de l’histoire de la technologie, comme la mine de charbon d’Ombilin, et des sites qui expriment les liens entre l’homme et son environnement, telles les collines de Prosecco, où les populations ont façonné le paysage en créant des terrasses pour cultiver les vignes.
En ce qui concerne les forêts hyrcaniennes, le premier dossier de nomination du site est venu d’Azerbaïdjan il y a 20 ans. Mais ce pays ne détient qu’un tout petit bout de ce massif forestier, qui n’a pas pu être inclus en tant que tel dans la liste du patrimoine, car il lui manquait l’intégrité requise pour être inscrit. Nous avons donc encouragé l’Iran, qui partage le même site, à présenter à son tour un dossier. Nous incitons les deux pays à engager une collaboration transfrontalière pour transmettre ce patrimoine naturel d’une valeur exceptionnelle.
Les réflexions à l’œuvre dans le processus qui conduit à ajouter des sites à la liste ont-elles changé au fil du temps? Reflètent-elles des enjeux liés à l’actualité de leur époque, tels que celui du changement climatique aujourd’hui?
Le texte de la Convention n’a pas changé, d’une part parce que ce n’est pas nécessaire, car il est très ouvert. D’autre part parce qu’il faudrait que d’éventuelles modifications soient adoptées par 193 États parties, ce qui représenterait aujourd’hui un pari presque impossible… Ce qui change, en revanche, c’est l’interprétation. Au début, l’accent n’était mis que sur le patrimoine bâti et sur des sites naturels exempts de toute intervention humaine. Aujourd’hui, nous accordons également de l’importance à des biens relevant par exemple du patrimoine technologique, tels que les sites de métallurgie ancienne du fer du Burkina Faso, inscrits en 2019, ou l’Observatoire de Jodrell Bank en Angleterre, qui a été construit au milieu du XXe siècle et qui a joué un rôle pionnier dans l’évolution de la radioastronomie, donc dans l’histoire de la façon dont l’homme regarde l’univers.
En ce qui concerne les enjeux environnementaux, ils ont toujours été présents. Les menaces liées à des «phénomènes d’altération ou de destruction» de l’environnement sont évoquées dans le préambule de la Convention du patrimoine mondial, qui est adoptée en 1972, l’année où se tient la première conférence sur l’environnement des Nations unies à Stockholm. Évidemment, la compréhension et la perception des phénomènes ont évolué. À l’époque, on se focalisait sur l’urbanisation et sur la pollution, aujourd’hui sur la diversité biologique et le changement climatique. Nous avons, à ce propos, 50 sites marins sur la liste. Nous y travaillons avec les agences gouvernementales, les gestionnaires de sites, la société civile et les ONG pour éliminer le plastique qui les menace. On peut recourir ainsi à l’angle du patrimoine afin de promouvoir des thèmes importants pour l’humanité.
Figurent dans la liste des sites liés aux aspects les plus sombres de la mémoire de l’humanité… Quelle conception du patrimoine prévaut dans le projet de «La Route de l’esclave?»
La liste du patrimoine inclut des «sites de mémoire», conformément au critère de sélection qui permet d’inscrire un site «directement ou matériellement associé à des événements» possédant «une signification universelle exceptionnelle». Auschwitz, par exemple, est classé au patrimoine mondial, non pas en raison de ses bâtiments, mais de l’histoire de l’Holocauste qui lui est rattachée. «La Route de l’esclave» représente un programme lancé par l’Unesco en 1994 pour contribuer à une meilleure compréhension de l’esclavage et de ses conséquences. Dans ce cadre, la Convention du patrimoine mondial est entrée en jeu en inscrivant des sites tels que l’île de Gorée, au large du Sénégal, qui a été le plus grand centre du commerce des esclaves de la côte africaine et qui conserve un ensemble de bâtiments témoignant de cette histoire. Le programme est lié à d’autres aspects, par exemple des formes musicales ou des expressions orales qui, si elles sont toujours vivantes, peuvent relever, quant à elles, d’une autre convention, celle de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine immatériel.
Les menaces qui pèsent sur le patrimoine sont-elles les mêmes qu’en 1972 ou ont-elles changé au fil des décennies?
En interviewant les pères et mères de la Convention pour écrire le livre La Convention du patrimoine mondial: La vision des pionniers avec Christina Cameron, j’ai pu mesurer à quel point toutes les menaces pesant sur le patrimoine culturel étaient déjà présentes dans les débats qui ont conduit à l’élaboration du texte : on parlait des guerres et du trafic d’œuvres, mais également de ce qu’on appelle aujourd’hui le «surtourisme» et de l’impact des grands projets d’infrastructures. La sauvegarde des monuments d’Abou Simbel lors de la construction du barrage d’Assouan a été à ce propos un des succès fondateurs de la Convention. Mais il est clair qu’au fil des décennies, la pression sur les sites du patrimoine mondial est devenue plus forte. Il y a beaucoup de projets de barrages, de routes traversant les sites, d’aéroports projetés à proximité… Depuis le début du XXIe siècle, il y a également davantage de destructions intentionnelles, qui vont des Bouddhas de Bâmiyân en Afghanistan (2001) à Palmyre en Syrie (2015), en passant par les mausolées de Tombouctou au Mali, détruits en 2012 et reconstruits par l’Unesco en 2015.
Avec plus de 1000 sites sur la liste, le travail de protection est devenu énorme et la tâche n’est pas toujours prise au sérieux. Sur le terrain, je constate souvent que les plans de gestion ne sont pas mis en œuvre, qu’il n’y a pas d’équipe veillant sur les sites, que les biens protégés ne sont pas inventoriés de manière complète. Pendant ce temps, les moyens financiers ont baissé: les pays riches contribuent moins au Fonds du patrimoine mondial, les autres n’en ont pas la possibilité, les sommes offertes par les donateurs privés se sont réduites. Aussi, nous avons des problèmes financiers. Les sommes mobilisées en France après l’incendie de Notre-Dame restent exceptionnelles : lorsque le Musée national de Rio au Brésil a brûlé en 2018, il n’y a pas eu de dons… Bien sûr, c’est aussi une question de priorités. Pour le Mali, c’était clair, il fallait absolument aider à reconstruire les mausolées de Tombouctou, les communautés considéraient qu’on ne pouvait pas vivre sans ces monuments. C’était culturellement trop important.
Deux sites ont été retirés de la liste…
Oui, le sanctuaire de l’oryx arabe en Oman, en 2007, et la vallée de l’Elbe à Dresde en Allemagne en 2009. Le sultanat d’Oman avait décidé de réduire la superficie du site pour l’ouvrir à l’exploitation des hydrocarbures. À Dresde, l’autorité locale voulait absolument construire un pont à quatre voies à travers le site, en coupant le paysage culturel en deux.
La menace du retrait de la liste ne fonctionne-t-elle pas comme un élément de pression?
Œuvrer pour la conservation représente notre tâche quotidienne. Cela concerne la partie immergée de l’iceberg, celle dont le public et les médias ne se rendent pas forcément compte. Il y a parfois plusieurs années de discussion, avec le pays concerné, et dans pas mal de cas, nous parvenons à sauver le site. Mais le déclassement, comme en Oman et à Dresde, est irréversible. On ne retourne pas sur la liste après en être sorti.
Y a-t-il des dossiers en cours touchant la Suisse?
L’ajout le plus récent pour la Suisse est l’œuvre architecturale de Le Corbusier, inscrite en 2016. Il s’agissait d’un dossier complexe en raison du caractère transnational de cette œuvre, avec des réalisations en Suisse, mais aussi en Argentine, en France, en Inde, en Allemagne, en Belgique et au Japon. L’inscription n’a pu être acceptée qu’après la mise en place d’une gestion conjointe de ce site localisé de façon éclatée dans le monde entier. Dans cette même lignée transnationale, qui représente une évolution dans l’application de la Convention, le site naturel des Forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe est partagé entre 12 pays, auxquels la Suisse voudrait aujourd’hui s’ajouter. Vous le voyez, c’est un travail de fourmi.
Bio express

1959 Naissance
1988 Doctorat à l’Université de Hambourg avec une thèse sur la recherche géographique sous le national-socialisme
1989 Rejoint en tant que chercheuse la Cité des sciences et de l’industrie à Paris
1990 Chercheuse invitée à l’Université de Californie à Berkeley
1991 Rejoint l’Unesco
2015 Devient directrice du Centre du patrimoine mondial de l’Unesco
2016 Publie avec Christina Cameron le livre Many Voices, One Vision: The Early Years of the World Heritage Convention (traduction française La Convention du patrimoine mondial: La vision des pionniers, 2017)