Séances de physiothérapie pour personnes sans statut légal, dépistage auprès des travailleuses et travailleurs du sexe, consultations pour sans-abris ou actions de prévention auprès de communautés précarisées : coup de projecteur sur quatre projets genevois qui cherchent à atteindre les individus exclus du système de soins.
TEXTE | Aurélie Toninato
La santé communautaire regroupe de nombreux projets qui ont pour objectif d’atteindre des publics marginalisés et exclus du système de soins. Au sein de la Haute école de santé de Genève (HEdS-GE) – HES-SO, plusieurs professionnel·les se sont spécialisés dans cette approche ouverte et inclusive de la santé en contexte communautaire.
Une main tendue aux sans-abris
Deux fois par semaine, le petit bureau des travailleuses et travailleurs sociaux de l’abri de protection civile de Richemont, à Genève, se transforme en consultation en soins communautaires pour les dizaines de sans-abris hébergés chaque nuit. Ce lundi soir, c’est Artur Pouseiro, infirmier de 29 ans, qui officie. Il a apporté des chocolats ; c’est sa dernière soirée à Richemont, après trois ans d’activité. Ici, pas de paravent ni de fauteuil médical, pas de rendez-vous ni d’obligation, pas de blouse blanche mais une veste en velours côtelé. Le halo bienveillant de l’infirmier éclipse la triste lumière jaune du plafonnier. Le cadre est informel, et c’est voulu. « On ne cherche pas à recréer un milieu médical, il faut éviter le plus de barrières possible », confie Artur Pouseiro.
Cette consultation infirmière in situ a vu le jour en 2017 suite à la demande de collaboratrices et collaborateurs sociaux œuvrant dans les abris d’urgence, sous l’égide de Mélanie Pinon, adjointe scientifique en soins infirmiers et infirmière spécialisée en psychiatrie clinique et santé mentale à la HEdS-GE. Installé dans l’abri de Richemont, le service montre rapidement sa pertinence. Aujourd’hui, la consultation, financée par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), se déploie en alternance dans les divers hébergements d’urgence de la Ville, avec une moyenne de 11 bénéficiaires par soir. Ce lundi, Artur Pouseiro accueillera quatre personnes, dont un homme qui distribue des sourires malgré un mal de dos qui le plie en deux, et une femme aux ongles violet pailleté, affaiblie par une mauvaise toux couplée à un état grippal. L’infirmier évalue, traite le plus urgent, redirige si besoin vers d’autres acteurs de santé gratuits, écoute et rassure, distribue quelques pilules. « Mais nous ne sommes pas une pharmacie. »

Le profil des bénéficiaires est hétérogène, du toxicomane au working poor, de l’étudiant·e au senior en passant par la ou le grand précaire à la rue depuis des années. « Certains ont perdu confiance en eux, dans les autres, dans le système de santé, témoigne Mélanie Pinon. Souvent, les seules fois où ils voient un·e médecin, c’est en ultime recours aux Urgences, quand leur état s’est dégradé. Certains peuvent ainsi y aller 15 à 20 fois en hiver. » Ceux qui poussent la porte de la consultation infirmière viennent surtout pour un suivi de maladies chroniques, des soins en santé mentale, des réponses à des plaintes somatiques. « C’est faux de dire qu’ils ne s’inquiètent pas de leur santé, soutient la responsable. La preuve : lorsqu’on leur offre une consultation in situ, ils saisissent la perche. Quand on vit dans la rue, qu’il faut chercher à manger, trouver où dormir, la santé n’est pas la priorité… La consultation ambulatoire mobile de soins communautaires des HUG (Camsco) fait un travail formidable. Mais il y a des horaires, il faut se déplacer, faire la queue. Pour beaucoup, c’est décourageant. »
La collaboratrice de la HEdS-GE soutient que la consultation a montré qu’il était possible de rattraper celles et ceux qui passent à travers les mailles du réseau de soins, de limiter les comorbidités liées à une non-prise en charge des maladies chroniques grâce à un travail de promotion de la santé et une détection précoce, de mettre en place un soutien pour les troubles mentaux, ainsi que d’augmenter le bien-être psychique des sans-abris. « L’essentiel : faire évoluer le regard que la société porte sur eux. » La présence d’un infirmier·ère fait aussi la différence pour les collaboratrices et collaborateurs des hébergements d’urgence. « Durant les neuf premiers mois du projet à Richemont, leurs appels au 144 ont diminué de 33% », rapporte Mélanie Pinon. Artur Pouseiro ajoute de son côté : « notre présence est un filtre. On peut répondre aux besoins immédiats et évaluer une situation, c’est rassurant pour les équipes. » Avec cette consultation, indique encore la responsable, « on essaie de sortir de l’urgence relative ; le plus important est de créer un lien avec ces personnes. » Et de leur offrir la considération dont elles sont souvent privées.
Dépistage gratuit pour les prostitué·es
Noelia Delicado travaille aussi avec une population à la marge, sans blouse blanche et in situ. L’infirmière, chargée de projets et maître responsable des enseignements de santé communautaire dans la filière de soins infirmiers de la HEdS-GE, consacre une partie de son temps à une consultation de santé sexuelle et de prévention pour les travailleuses et travailleurs du sexe. « Ça apporte beaucoup à mon expérience professionnelle et je l’utilise dans mes cours, pour ouvrir les étudiant·es à d’autres réalités de soins. »
Tout a démarré en 2006, avec une consultation de conseil et de test volontaire du VIH pour personnes migrantes, cofinancée par les HUG, l’Office fédéral de la santé publique et la Direction générale de la santé en collaboration avec le Groupe Sida Genève. En 2011, l’intervention s’ouvre également aux travailleuses et travailleurs du sexe, en collaboration avec Aspasie, une association qui défend leurs droits. Depuis 2017, la consultation de proximité gratuite est installée deux soirs par mois dans les locaux de l’association, aux Pâquis, haut lieu de la prostitution à Genève. Deux autres offres se sont développées en parallèle, dans des bus itinérants à la rue des Alpes et au Boulevard Helvétique. On y trouve 80% de femmes, rarement suisses, et quelques hommes. La consultation et l’accueil itinérant ont accueilli 103 travailleuses et travailleurs du sexe en 2022.
« Le but premier était de rendre accessible le dépistage des infections sexuellement transmissibles à une population à risques, explique Noelia Delicado, qui participe à la consultation depuis 2016. Mais en réalité, on va plus loin. Le dépistage est une accroche pour entrer en contact, pour faire de la prévention de bas seuil, pour évaluer les besoins sur d’autres problématiques – gynécologie, addictions, violences –, et pour rediriger vers les réseaux socio-sanitaires partenaires. » Elle relève que les prostitué·es sont généralement soucieux de leur santé mais que la plupart ne prennent pas le temps nécessaire pour s’en occuper car « seul le travail compte ». L’enchaînement de relations sexuelles peut pourtant être traumatique pour le corps et l’esprit.
La prostitution étant une activité légale à Genève, les travailleuses et travailleurs du sexe ont un statut légal sur le territoire et une assurance-maladie. Pourquoi une consultation gratuite est-elle alors nécessaire ? « Celles qui viennent chez nous sont en situation de précarité financière, répond Noelia Delicado. Elles sont vulnérabilisées, de par leur activité, la violence de certains client·es ou de leurs conditions de travail. De plus, le contexte migratoire influe sur leur santé, indirectement, en se répercutant négativement sur leur situation personnelle, sociale, économique. À cela s’ajoutent parfois d’autres traumatismes et un faible niveau de littératie, donc des difficultés à savoir où aller se faire soigner. » Et de conclure : « On essaie de discuter des risques en vue d’une prise de conscience et de réfléchir ensemble à des stratégies pour faire au mieux. Ou faire au moins pire. »
De la physiothérapie pour les sans-papiers
Une autre consultation unique à Genève a lieu directement dans les locaux de la HEdS-GE, de mi-octobre à début août. Assurée par des étudiant·es de 2e ou 3e année en filière physiothérapie, cette intervention offre un accès gratuit à une évaluation et des traitements à des migrant·es en situation de précarité. Elle existe depuis 1995, grâce à une convention de collaboration entre la HEdS-GE et les HUG. Elle est reconnue par la Direction générale de la santé genevoise comme lieu de soin spécifique pour la population de sans-papiers, ainsi que par la HES-SO comme lieu officiel de formation pratique pour le cursus. « Cette consultation s’adresse aux personnes en grande vulnérabilité, dans un contexte socio-économique compliqué. La plupart sont sans statut légal et pratiquement toutes et tous n’ont pas d’assurance », détaille Jean-Luc Rossier, physiothérapeute et ex-chargé d’enseignement à la HEdS-GE – il est retraité depuis septembre 2023 –, qui a repris la responsabilité de la consultation en 2004.
En 2022, cette offre de physiothérapie a pris en charge 550 patient·es avec un âge moyen de 45 ans, dont 66% de femmes – essentiellement originaires d’Amérique du Sud et d’Asie – et 34% d’hommes en majorité d’Afrique du Nord et subsaharienne. Ces bénéficiaires travaillent dans l’économie domestique – ménage et garde d’enfants –, dans la construction, l’hôtellerie, le commerce, la vente ou l’agriculture. Neuf fois sur dix, ils sont référés par la Camsco. Les motifs de consultation les plus répandus sont les lombalgies, les cervicalgies et dorsalgies chroniques, l’arthrose au genou et à la hanche, des maux de tête à cause des tensions, des conséquences post-opératoires ou d’accidents de travail, ainsi que des problèmes psychosociaux. « Par ailleurs, certain·es sont confrontés à des situations de violence psychologique, voire physique, dans leur quotidien. »
À l’heure où la pérennité de cette offre et son financement sont remis en question, le jeune retraité tient à rappeler son importance. Pour les étudiant·es, d’une part, qui doivent apprendre à soigner différemment selon les cultures ou les limites des patient·es. Ils vivent une expérience qui leur ouvre les yeux sur ces personnes migrantes. « C’est très riche sur le plan humain. » Pour les migrant·es, d’autre part, « car nous sommes les seuls à proposer de tels soins gratuitement et nous répondons à une demande. Nous sommes un maillon d’une chaîne. »
Promouvoir la santé par les pair·es
Enfin, un autre projet vise aussi à être un maillon supplémentaire entre des communautés et le système de santé : celui de l’association Agents de santé. Il s’agit de personnes issues de communautés avec des besoins spécifiques formées pour coanimer des ateliers de promotion de la santé auprès de leurs pair·es. En 2019, après une phase-pilote, Delphine Amstutz, chargée de cours dans la filière nutrition et diététique de la HEdS-GE, crée cette association avec sa consœur Daniela Gonçalves pour des communautés avec des besoins en santé spécifiques, comme des migrant·es ou des seniors. Les ateliers démarrent un an plus tard, autour de trois thématiques. Premier axe, la nutrition : « Chez les personnes migrantes, de nombreuses maladies chroniques se développent suite à leur arrivée en Suisse, où leurs ressources limitées causent une péjoration de leur alimentation, rapporte la diététicienne. Nous voulons intervenir en amont pour montrer comment et où ils peuvent se nourrir de manière équilibrée avec un budget limité. » Certains ateliers de cuisine sont d’ailleurs organisés à la HEdS-GE.
Deuxième axe, la santé mentale : « Ces communautés souffrent souvent d’un état de stress chronique lié à l’incertitude, aux difficultés économiques, à la précarité de l’emploi. Cela joue un rôle dans l’apparition de certaines maladies. » Dernier axe : l’activité physique, « en montrant comment sortir de la sédentarité, sans forcément avoir besoin de payer un abonnement dans un club ». Le recrutement des agent·es de santé communautaire se fait en collaboration avec l’Hospice général. Les volontaires suivent plusieurs jours de formation avec des professionnel·les de santé, avant de coanimer les ateliers. Les agent·es bénéficiaires de l’Hospice sont défrayés par ce dernier, qui considère le projet comme une activité de réinsertion. Pour les autres, c’est l’association – financée principalement par Promotion Santé Suisse et la Direction générale de la santé cantonale – qui les rémunère. Une dizaine d’agent·es sont formés chaque année et près de 140 personnes issues de la migration ont été touchées par les ateliers en 2022.
Pour Delphine Amstutz, grâce à la sensibilisation par les pair·es, le message a plus de chances d’atteindre sa cible car ils connaissent la langue et les habitudes de vie. « Pour leur communauté, ils sont dignes de confiance et parfois plus crédibles que les professionnel·les de santé. » Ils servent également de relais « car ils vont parler des ateliers avec leurs proches. Eux-mêmes ont amélioré leurs pratiques et les diffusent autour d’eux. C’est précieux car l’une de nos grandes difficultés est d’atteindre ces populations. »
Les difficultés d’une définition de la santé communautaire
La santé communautaire fait partie intégrante de la santé publique, mais elle se concentre davantage sur l’amélioration de la santé ainsi que du bien-être d’une communauté spécifique, impliquant sa participation. Elle constitue aussi une stratégie de promotion de la santé. Mais encore ? Il est difficile de donner une définition universelle de ce concept. L’équipe d’Annie Oulevey Bachmann, professeure et responsable du laboratoire d’enseignement et de recherche Prévention et promotion de la santé dans la communauté à l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source – HES-SO, s’attelle à en élaborer une qui fasse consensus en son sein. « Ce qui est complexe, explique-t-elle, c’est que derrière ce terme se cachent des visions du monde différentes selon qu’on s’intéresse à la santé versus la maladie, à la mobilisation
des ressources de santé versus l’action sur la limitation des risques. Il y a un ancrage épistémique et politique dans la manière dont on considère ces éléments. »
Les interventions pour améliorer la santé des communautés dépendent donc de la perspective avec laquelle on aborde le concept de santé. Dans la vision anglo-saxonne par exemple, l’expression « community health » recouvre une politique de santé plutôt centrée sur la maladie et la guérison. « Pour schématiser, on peut dire que c’est une vision plutôt top down, alors que dans certains pays francophones notamment, on est plus dans le bottom up, dans une recherche d’horizontalité. » Dans cette perspective, il s’agit ainsi moins de « faire pour » les gens que de mettre en place les conditions favorables pour qu’ils agissent eux-mêmes pour leur santé. « La dimension de promotion de la santé en amont de l’apparition de maladies est plus prégnante, tout comme la volonté de travailler avec les communautés et leurs ressources en favorisant leur empowerment. » Autre difficulté : le terme englobe à la fois une méthode de travail et un résultat. « Pour plus de clarté, avec mon équipe, nous envisageons donc d’utiliser dorénavant deux expressions distinctes : les ‹approches communautaires› pour parler de la manière d’appréhender la santé des communautés, incluant notamment les méthodes participatives, et la ‹santé des communautés› pour parler du but recherché et des résultats. »
Trois questions à Mathieu Arminjon
Le stress psychosocial accroît la vulnérabilité, considère Mathieu Arminjon, adjoint scientifique et historien de la médecine à la Haute École de Santé Vaud (HESAV) – HES-SO, qui a publié Inégalités de santé. Fondements historiques et enjeux contemporains de l’épidémiologie sociale (2023).
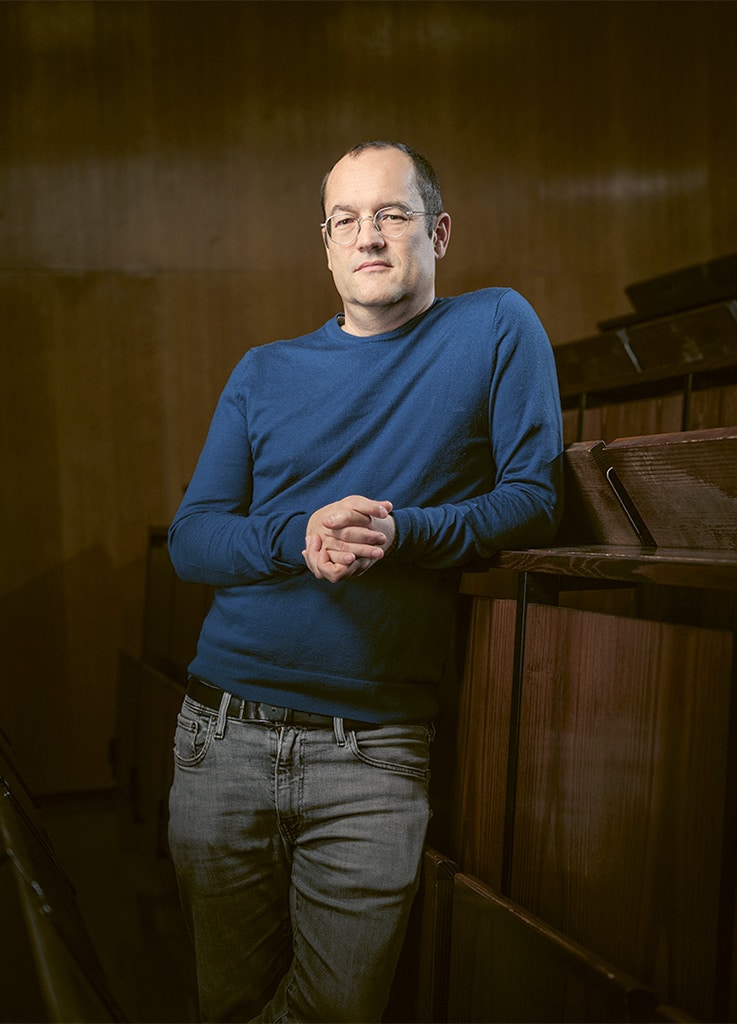
La santé des personnes précarisées est-elle en général moins bonne que celle des plus aisées ?
MA Oui, c’est un fait largement documenté depuis longtemps. Déjà au XIXe siècle, le médecin français Louis René Villermé (1782-1863) avait corrélé le taux de mortalité avec le montant des impôts par quartiers à Paris. On mourait davantage là où on payait le moins d’impôts. Après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux pays ont mis en place des systèmes d’assurance et on pensait que les inégalités en termes de santé avaient disparu. Mais en 1980, un rapport en Grande-Bretagne a montré qu’il n’en était rien : l’espérance de vie avait augmenté, mais l’écart entre les classes sociales s’était creusé.
Comment expliquer cette différence ?
On a tendance à penser que les formes de vulnérabilité sont uniquement déterminées par des aspects génétiques, comportementaux, et un manque d’accès aux soins. Or, à consommation égale de cigarettes, on meurt plus quand on est défavorisé. Plus on est en bas de l’échelle, plus on va accumuler des facteurs de vulnérabilité dont une intégration sociale plus faible, un métier peu valorisé, un bas salaire, moins de temps pour les loisirs, etc. Cela entraîne un stress psychosocial, source de maladie soit directe, soit indirecte car il accroît la vulnérabilité aux maladies. Lorsque que l’on constate des inégalités de santé dans un pays riche comme la Suisse, où les besoins élémentaires sont assurés pour une large part de la population, le stress psychosocial est la meilleure piste pour les expliquer.
Selon vous, ces inégalités ne sont pas assez documentées en Suisse. Pourquoi ?
Il n’existe pas d’études régulières sur l’état de santé corrélé au statut social. Les cultures de recherches et nos représentations de la santé sont encore centrées sur les aspects bio-médicaux, et ce sujet est hautement politique. En 2020, un débat a eu lieu au Conseil national suite à une interpellation de la commission des finances, qui estimait que les statistiques étaient trop lacunaires pour se prononcer sur une révision de l’AVS. L’un des arguments en faveur de cette révision était l’augmentation de l’espérance de vie. Sauf que celle-ci n’est en réalité pas la même pour toutes et tous : en France, par exemple, on estime qu’il y a un écart d’espérance de vie de plus de dix ans entre les plus défavorisés et les plus riches ! Dans les classes plus précaires, au moins un quart des gens ne profitent jamais de leur retraite car ils meurent avant. C’est comme s’ils payaient la retraite des plus favorisés… Il y a de grands risques que cela soit aussi le cas en Suisse. La demande de la commission a été rejetée au motif qu’il était trop compliqué d’établir une classification des classes sociales et qu’il n’était pas justifié de prendre des mesures politiques sur la base de statistiques. Je plaide pour ma part pour que les citoyen·nes puissent décider en étant informés.

