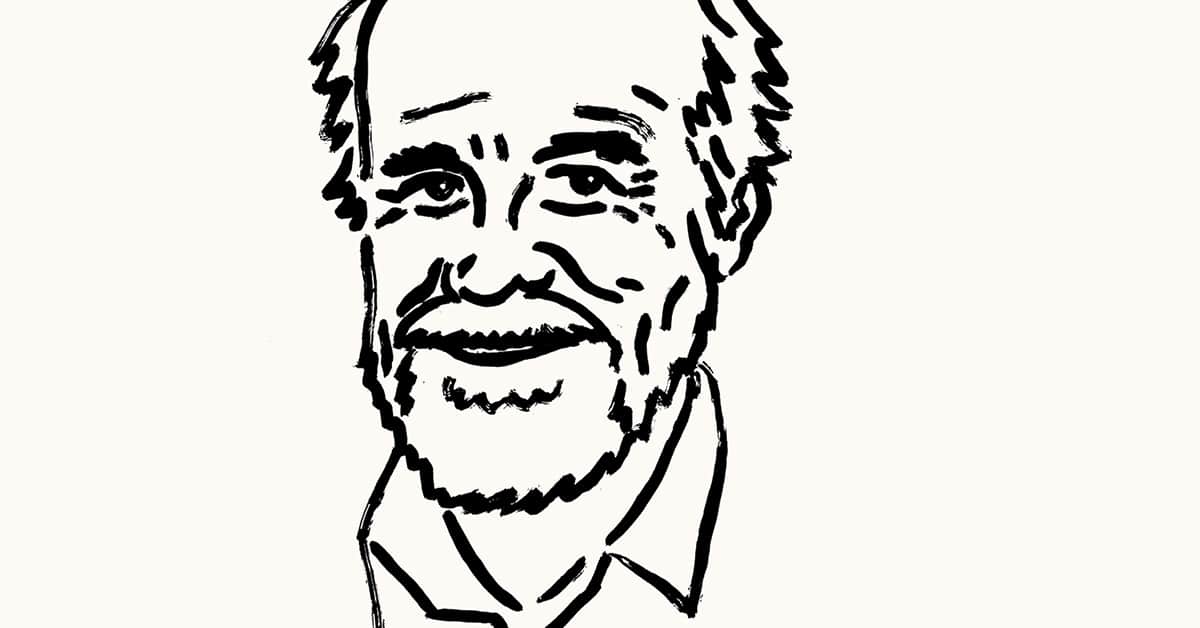La métropolisation du monde a englouti les sociabilités, remplacé les proximités par la promiscuité, livré nos vies quotidiennes à une surenchère de mobilité forcée. C’est pourtant à partir des villes que le monde pourrait recommencer à respirer. Tel est le pari de Carlos Moreno, porte-drapeau des nouvelles urbanités.
TEXTE | Nic Ulmi
ILLUSTRATION | Alexandre Pointet
Où va-t-on, en quinze minutes? Partout, si on se trouve dans la ville idéale imaginée par Carlos Moreno. Partout, non pas parce qu’on irait très vite ou que la ville en question serait très petite, mais parce que tout ce dont nous aurions besoin serait placé dans un rayon de 1 à 5 kilomètres de distance. Tel est le modèle de la «ville du quart d’heure» préconisé par cet acteur à large spectre des «nouvelles urbanités», entrepreneur dans les technologies de la smart city, directeur scientifique de la chaire Entrepreneuriat Territoire Innovation à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, conseiller en «villes intelligentes» de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Mais comment réalise-t-on un tel miracle urbanistique? La réponse passe par une «défétichisation» de la mobilité, par des bâtiments qu’on rend systématiquement polyvalents et par la prise en compte du fait que la distance métrique, c’est-à-dire mesurable, ne fait pas tout. Pour réhumaniser la vie dans les villes (c’est-à-dire la vie tout court, puisque dans quelques décennies les villes abriteront, selon les projections, la quasi-totalité de l’humanité), il faut ouvrir un éventail de nouvelles proximités.
Dans votre nouveau livre Droit de cité. De la «ville-monde» à la «ville du quart d’heure», vous ouvrez une fenêtre sur votre histoire personnelle. Cela donne envie d’en savoir plus, en vous demandant comment se sont forgées, au fil de votre vie, votre relation à la ville et votre volonté de renouveler la dialectique de la distance et de la proximité.
Je suis né il y a 62 ans dans ce qui à l’époque était une petite ville à 3’000 mètres d’altitude dans la cordillère des Andes, en Colombie. Mon père était d’origine paysanne, lui et sa mère avaient eu un lopin de terre dont ils avaient été chassés par la violence du processus d’expropriation des terres qui a sévi dans le pays dans les années 1950. Comme des millions d’autres paysans, mon père est devenu alors un urbain malgré lui. Pour gagner sa vie, il a dû ensuite migrer à nouveau vers la capitale, Bogota, puis vers d’autres villes du pays. J’ai le souvenir qu’à chaque fois qu’on arrivait quelque part, il essayait d’avoir un potager, un poulailler, un lapin… Mais la pression de la vie urbaine devenait de plus en plus incompatible avec ses habitudes.
Je viens donc d’une famille de sept enfants, tous nés urbains, mais avec un père qui a toujours gardé le goût de la terre et l’envie de renouer avec la nature. J’ai vécu ainsi dans une dichotomie entre la ville qui nous a happés et envoûtés, d’une part, et d’autres repères, enracinés dans un autre mode de vie, qu’on se bat aujourd’hui pour retrouver face au sentiment d’une perte d’humanité dans le processus de construction des métropoles.
À 15 ans, je me suis engagé dans un mouvement de contestation – y compris les armes à la main, parce que l’Amérique latine de l’époque était ainsi – dont le combat portait sur la propriété de la terre et sur les droits des communautés indiennes. Une bataille qu’on a perdue. C’est ainsi que j’ai dû quitter le pays à l’âge de 20 ans et que je me suis retrouvé comme réfugié politique à Paris, une grande capitale mondiale dans l’effervescence urbaine des années 1980, qui n’avait rien à voir avec l’environnement pour lequel je m’étais battu.
À partir de là, vous passez de ce tiraillement entre ville et campagne à la quête d’une synthèse entre vie métropolitaine et proximités réinstaurées…
Le déclic s’est produit lorsque je me suis mis à voyager un peu partout dans le monde, et en particulier lorsque j’ai visité la Mongolie. Après avoir passé du temps dans le désert de Gobi, la région avec la plus faible densité de population de la planète, où vivent des nomades aux traditions fortes, j’ai eu un choc brutal en arrivant dans la capitale, Oulan-Bator, avec ses blocs de béton, son habitat vertical qui cassait les sociabilités, son taux de pollution parmi les plus élevés au monde.
Le déclic est donc venu de la rencontre avec ces contrastes, avec ces contrées qui luttaient contre leur métropolisation en gardant des réminiscences d’autres modes de vie, et en même temps du constat que le processus qui conduit une partie croissante de l’humanité à vivre dans des métropoles est irréversible. J’ai compris ainsi que la respiration du monde ne pouvait venir que des villes et que notre seule chance de résilience implique que nos villes se transforment à une échelle humaine. De là est parti mon processus de réflexion sur la manière d’humaniser la vie urbaine.
Cette réhumanisation passe par une réflexion sur les proximités, dont vous soulignez la nécessité de toujours parler au pluriel.
Les proximités, en effet, peuvent être de plusieurs natures: spatiale, physique, temporelle, sensorielle, affective… Aujourd’hui, elles se présentent également sous la forme d’une ubiquité engendrée par l’hyper-connectivité numérique, qui produit des impressions de voisinage dans un espace «non métrique», comme dirait le philosophe Michel Serres, c’est-à-dire où les distances mesurables ne jouent plus aucun rôle. Je pense donc qu’il faut absolument aborder les proximités à partir d’une approche multidimensionnelle. Malheureusement, il y a souvent une grande confusion dans l’usage du terme «proximité», avec une tendance à le considérer uniquement comme une notion spatiale, ou à assimiler proximité et promiscuité, qui sont évidemment des choses complètement différentes. Vous connaissez la phrase d’Albert Camus selon laquelle «mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde». Il en va ainsi pour les proximités. Bien sûr, il y a une composante métrique, spatiale, qui se traduit pour moi dans la revendication d’une densité urbaine que j’appelle organique, permettant à la fois de ne pas subir la promiscuité et d’avoir une masse critique qui facilite la création du lien social. Mais si on veut que les nouvelles proximités soient heureuses, il faut les aborder, plus largement, en lien avec leur capacité à remplir les fonctions sociales qui correspondent à nos besoins. À travers mon travail, j’ai défini ainsi six fonctions clés: habiter, travailler, s’approvisionner, se soigner, s’éduquer et s’épanouir. Ces fonctions se trouvent au cœur de la «ville du quart d’heure» et de son élargissement aux environnements moins denses, le «territoire de la demi-heure».
L’accès aux lieux qui remplissent ces six fonctions, dites-vous, ne devrait pas passer par une mobilité améliorée, mais au contraire par une «démobilité» qui renverse les termes de l’équation. Comment fonctionne ce retournement?
J’ai formulé cette idée en 2015, lors de la Conférence de Paris sur les changements climatiques (COP21), en disant que si les villes veulent contribuer à diminuer les émissions de CO2, elles doivent s’attaquer à la mobilité non pas tant en la rendant plus propre, ou en développant des transports en commun qui vont plus vite et plus loin, mais en questionnant l’utilité des déplacements. J’ai commencé alors à étudier les corrélations entre le bâti et les besoins sociaux qui déclenchent ces déplacements, et j’ai réalisé qu’une part énorme de ce bâti est monofonctionnelle, dédiée à un seul usage, et qu’elle n’est donc utilisée que pendant une petite fraction du temps où elle pourrait servir. Ce qui représente un vrai gâchis.
Je me suis donc dit que, plutôt que d’aller plus vite et plus loin, il vaudrait mieux utiliser les ressources disponibles à proximité, évitant ainsi des déplacements inutiles. La démobilité qui en résulterait et que je préconise ne signifie donc pas qu’on assignerait les gens à résidence, mais qu’on diminuerait ces déplacements obligés, quittant la mobilité subie pour aller vers une mobilité choisie.
Mon paradigme de changement du modèle urbain se situe ainsi à la convergence de trois aspects. Le premier est le chrono-urbanisme, qui travaille sur la manière de changer le rythme de vie dans nos villes. Le deuxième est la topophilie, l’«amour des lieux», un sentiment d’appartenance et un lien affectif avec la ville qui conduit à s’y investir en prenant soin du bien commun. Et le troisième est la chronotopie, qui consiste à voir comment un lieu peut changer de fonction au fil des heures, des jours et des périodes de l’année.
Y a-t-il des exemples d’expériences concrètes allant dans cette direction?
J’ai été très fier lorsque la maire de Paris, Anne Hidalgo, a fait voter en décembre 2020 au Conseil de Paris une toute première mesure liée à la mise en place de la ville du quart d’heure, à savoir l’ouverture des écoles le week-end pour autre chose que des activités pédagogiques. Jusqu’ici, et depuis l’instauration de l’instruction obligatoire par Jules Ferry à la fin du XIXe siècle, les écoles n’ouvraient le week-end que pour accueillir les bureaux de vote lors des élections, éventuellement pour des réunions de parents d’élèves. Aujourd’hui, après un délai d’expérimentation de janvier à avril 2021, la Ville de Paris a lancé un appel à projets pour une ouverture des écoles à des activités liées au voisinage, au quartier.
Comme Paris, d’autres villes européennes, telles que Milan, Dublin ou Valence, ont lancé des projets qui reprennent le modèle de la «ville du quart d’heure» au cours de 2020, année pandémique. Est-ce une coïncidence?
En 2016, lorsque j’évoquais ce nouveau paradigme pendant la COP21, on me disait: ton idée est super, mais elle ne pourra pas se réaliser, parce qu’on ne travaillera jamais près de chez soi. Vous voyez que cinq ans après c’est le contraire qui se passe: on est obligé de travailler très près de chez soi, même trop! Du coup, la démobilité est devenue une chose dont tout le monde s’est mis à parler… Sur un plan plus général, le C40 – une organisation qui rassemble une centaine des plus grandes villes du monde et qui vise à lutter contre le changement climatique – a adopté le concept de la «ville du quart d’heure» pour que la relance post-pandémique aboutisse à des villes réhumanisées.
Bio express

1959 Naissance en Colombie
1979 Arrive en France en tant que réfugié politique
1981 Commence à travailler dans la robotique industrielle à l’Université Paris-Sud
1995 Crée l’équipe Systèmes distribués adaptatifs et réactifs (SyDRA) à l’Université d’Évry-Val d’Essonne
1998 Crée la start-up Sinovia, active dans le domaine des technologies pour la ville intelligente et durable, sur le campus d’Évry-Val d’Essonne
2010 Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur
2017 Cofondateur et directeur scientifique de la Chaire ETI, Entrepreneuriat, Territoire, Innovation, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2019 Médaille de la prospective de l’Académie d’architecture
2020 Le concept de la «ville du quart d’heure» est adopté par la maire de Paris, Anne Hidalgo, et par le réseau mondial des villes C40