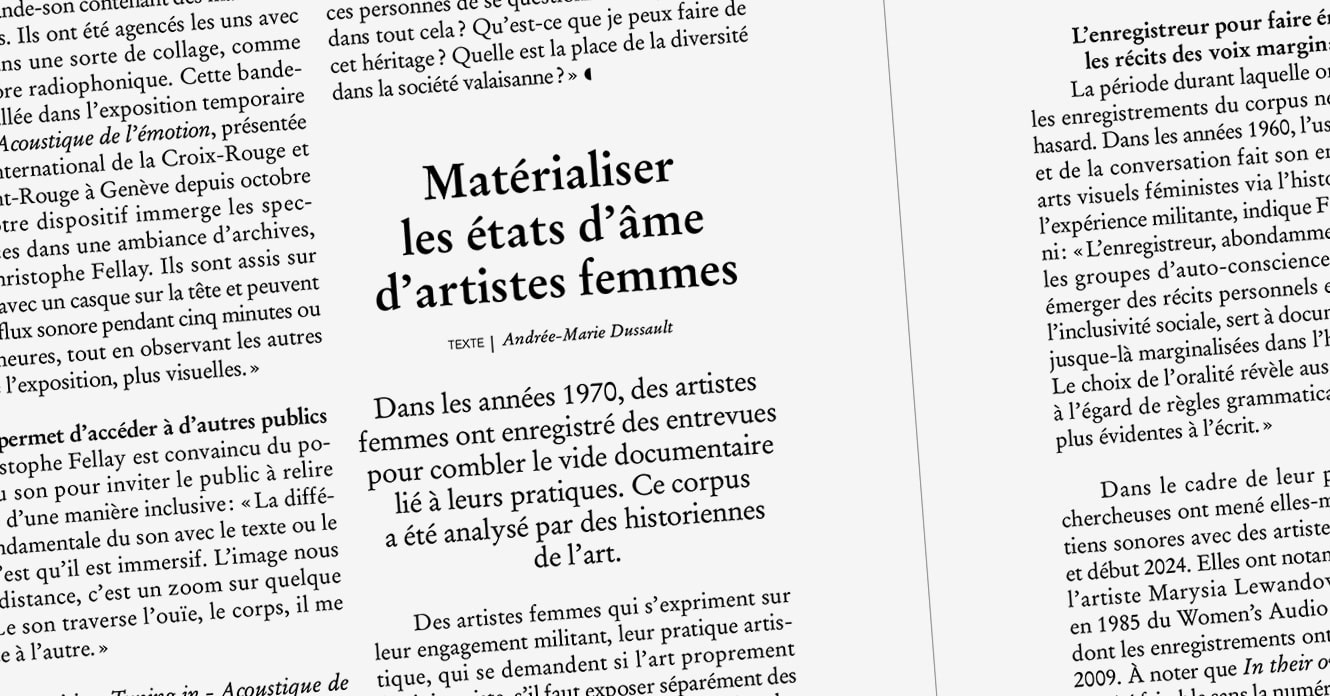Dans les années 1970, des artistes femmes ont enregistré des entrevues pour combler le vide documentaire lié à leurs pratiques. Ce corpus a été analysé par des historiennes de l’art.
TEXTE | Andrée-Marie Dussault
Des artistes femmes qui s’expriment sur leur engagement militant, leur pratique artistique, qui se demandent si l’art proprement féminin existe, s’il faut exposer séparément des hommes… Ces conversations réalisées dans les années 1970 et 1980 ont été enregistrées sur des cassettes audios. Elles visaient à combler le vide documentaire qui entourait alors les pratiques artistiques des femmes. Un corpus qui a été réuni et étudié par Julie Enckell Juillard et Federica Martini, toutes deux historiennes de l’art et professeures à la Haute école d’art et de design – Genève (HEAD – Genève) – HES-SO, dans le cadre du projet In their own words.
« Les années 1970 constituent une phase pionnière des arts et de l’histoire de l’art féministe, fait valoir Federica Martini. Notre projet est né du constat de la faible visibilité de l’histoire orale féministe. Les enregistrements de conversations d’artistes femmes ont représenté jusqu’à présent un répertoire largement délaissé. Il nous paraissait intéressant de les analyser en regard du récent retour d’intérêt pour cette sorte d’oralité dans de nombreux podcasts. Et parce qu’on peut trouver dans ces entretiens une forme collective d’écriture de l’histoire qui passe par l’immédiateté de la parole. »
L’enregistreur pour faire émerger les récits des voix marginalisées
La période durant laquelle ont été réalisés les enregistrements du corpus ne doit rien au hasard. Dans les années 1960, l’usage de la voix et de la conversation fait son entrée dans les arts visuels féministes via l’histoire de l’art et l’expérience militante, indique Federica Martini : « L’enregistreur, abondamment utilisé dans les groupes d’auto-conscience 1Les groupes d’auto-conscience féministes ont émergé dans les années 1960 et 1970, notamment aux États-Unis. Ils permettaient à des femmes de se réunir pour partager des expériences personnelles afin de comprendre comment celles-ci étaient liées à des structures de pouvoir et de domination systémiques. afin de faire émerger des récits personnels et d’augmenter l’inclusivité sociale, sert à documenter des voix jusque-là marginalisées dans l’histoire de l’art. Le choix de l’oralité révèle aussi une méfiance à l’égard de règles grammaticales patriarcales plus évidentes à l’écrit. »
Dans le cadre de leur projet, les deux chercheuses ont mené elles-mêmes des entretiens sonores avec des artistes entre mai 2023 et début 2024. Elles ont notamment interviewé l’artiste Marysia Lewandowska, fondatrice en 1985 du Women’s Audio Archive (WAA), dont les enregistrements ont été numérisés en 2009. à noter que In their own words n’aurait pas été faisable sans la numérisation des fichiers sonores, qui étaient devenus inécoutables en raison de l’obsolescence de la technologie. «Marysia Lewandowska n’a pas voulu nettoyer le son ou faire de montage au moment de la numérisation, souligne Federica Martini. Ce, par souci de fidélité à l’oralité. À l’époque qui nous intéresse, souvent, dans une quête d’une approche à la fois documentaire et subjective, la source sonore originale n’était pas remaniée. »
Dans ce contexte, Julie Enckell et Federica Martini ont observé que les dialogues enregistrés avaient pu donner lieu à plusieurs transcriptions et, donc, à plusieurs versions de la rencontre. Cela a par exemple été le cas d’une entrevue conduite par l’historienne de l’art Cindy Nemser (1937-2021) avec l’artiste américaine Eva Hesse (1936-1970), publiée 3 fois entre 1970 et 1975. Dans la revue Artforum, l’interview écrite correspond à une prise de parole plutôt traditionnelle sur sa pratique artistique. Dans le Feminist Art Journal, l’entrevue publiée – après la mort prématurée d’Eva Hesse – est plus subjective, avec l’introduction d’éléments supplémentaires liés à sa biographie. Enfin, dans l’anthologie Art Talks, l’entretien, plus exhaustif, est encore plus fidèle à la conversation entre les deux protagonistes, avec l’annotation des hésitations, des rires, et l’évocation des états d’esprit de l’artiste.
Retour des pratiques d’écoute avec les podcasts féministes
Federica Martini rappelle que les artistes américaines et européennes autofinançaient leurs travaux et que c’est toujours le cas aujourd’hui. Elle constate que le fichier sonore comme pratique d’écoute opère un retour, relevant l’importance des podcasts féministes et liés à l’art contemporain à l’époque actuelle : « Au même titre que les pratiques féministes des années 1970, le podcast est plutôt une conversation, un partage de parole, sans hiérarchie.» Les chercheuses ont elles-mêmes produit un podcast dans le cadre de leur projet, en ligne depuis octobre 2024. « On peut être ému par l’écriture, mais dans le fichier sonore, le registre des émotions peut être encore plus fort, soutient Federica Martini. Dans l’entrevue enregistrée, il n’y a pas que le récit et la conversation. Les émotions et les états d’âme se matérialisent dans l’enregistrement. Par exemple, les silences, les mouvements répétitifs de quelqu’un qui est mal à l’aise, ou encore, les frottements, qui sont difficiles à transcrire, sont aussi éloquents.»
Explorez nos contenus sonores
Conversation entre les artistes Susan Hiller (1940-2019) et Marysia Lewandowska en 1988, qui figure dans la collection Women’s Audio Archive, fondée par cette dernière.
Conversation entre l’artiste Margaret Harrison et l’historienne de l’art Lucy Lippard datant de 1979 et hébergée dans le fonds Audio Arts de la Tate à Londres.
Audio Arts: Volume 4 No 1