Nous vivons dans un monde saturé d’images. Leur production augmentera-t-elle infiniment? Peut-être, mais pas notre attention qui demeure limitée. Et dans la compétition pour obtenir cette dernière, les algorithmes effectuent un tri qui limite, lui aussi, les sujets et les esthétiques qui nous sont présentés. Pistes de réflexion.
TEXTE | Geneviève Ruiz
Entre 2010 et 2019, la population mondiale a pris plus de 8,6 billions de photos, soit sept fois plus que durant la décennie précédente. Ces chiffres proviennent de l’entreprise Rise Above Research, qui fournit des études de marché pour l’industrie digitale. Elle prévoit qu’en 2021, 7,9 billions de photos seront stockées, chiffre qui devrait atteindre 10 billions en 2023. Prises à 90% au moyen de smartphones, ces photos sont destinées dans leur grande majorité à circuler sur les réseaux sociaux.
Des chiffres vertigineux, qui dépassent notre capacité d’entendement. «Plus de 3 milliards de photos circulent tous les jours sur les réseaux sociaux, souligne Emmanuel Alloa, professeur d’esthétique et philosophie de l’art à l’Université de Fribourg et auteur de trois anthologies intitulées Penser l’image. Nous manquons de concepts pour saisir ces quantités.» Paradoxalement, les images prennent une place si importante dans nos vies, dans les médias, dans les sciences ou dans l’économie, que nous n’arrivons plus très bien à les définir. Qu’est-ce donc qu’une image?
L’image n’est pas une représentation
«Je commencerai par préciser ce qu’une image n’est pas, avance Emmanuel Alloa. L’image n’est pas une représentation, au sens d’une réalité redoublée, d’un double du réel.» Cela vaut pour les images artistiques, comme pour les images scientifiques prises par les microscopes ou les IRM. L’image ne restitue jamais un donné ou des données, mais donne à voir, elle fait apparaître ce qui échappait à la vue. Ainsi, elle opère un tri sur le réel, elle le met en forme. Ce pouvoir a toujours suscité des craintes. «L’image est liée à deux grands malentendus, poursuit le philosophe. Elle n’est ni une fenêtre transparente, ni un écran opaque. Il s’agit d’une présentation, pas plus ni moins.»
L’être humain a-t-il toujours produit et fait circuler des images? Il semblerait que oui. Pour certains théoriciens, comme Hans Jonas, la fabrication de visibilités artificielles marque une étape essentielle dans le passage vers l’humain. Il va même plus loin dans son essai Homo pictor: la production d’images constituerait même le trait distinctif de l’être humain par rapport au règne animal, contrairement au langage ou à l’utilisation d’outils. La frénésie visuelle actuelle n’aurait alors rien d’étonnant. L’être humain produit des images depuis longtemps. Des bouleversements ont bien entendu eu lieu ces vingt dernières années, mais ils peuvent être relativisés en regard de l’histoire: la circulation, tout comme le contrôle des images, ont toujours existé. Qu’est-ce qui a vraiment changé?
Permanences et ruptures historiques
Aujourd’hui, la quantité d’images est certes exponentielle. Mais, comme l’écrit le sociologue Dominique Cardon dans son ouvrage intitulé Culture numérique, on peut considérer que «95% des navigations se déploient sur seulement 0,03% des contenus numériques disponibles. Nous pensons surfer sur l’immensité des données numériques, alors qu’en réalité, nous errons sur un minuscule confetti.» Une limitation de contenus à mettre en lien avec une uniformité esthétique: «Le fait que la grande majorité des images soient prises avec des smartphones leur confère des paramètres esthétiques similaires, en raison du format de ces appareils, mais aussi des applications de traitement de photos dont ils sont équipés», précise Emmanuel Alloa. Un nombre exponentiel d’images n’induit donc que dans une mesure limitée une diversité de contenus et de formats.
Peter Szendy, professeur en humanités et en littérature comparée à l’Université Brown (USA), auteur du Supermarché du visible et commissaire – avec Emmanuel Alloa – de l’exposition Le Supermarché des images qui s’est tenue au Jeu de Paume à Paris en 2020, explique de son côté que les images ont toujours circulé et ont toujours été échangées, suivant les axes routiers ou migratoires: «Cette circulation s’est multipliée et accélérée de manière exponentielle avec le développement d’internet et des réseaux sociaux, à tel point que l’on peut dire que l’image se confond désormais avec sa circulation. Elle apparaît de plus en plus comme une cristallisation momentanée des vitesses qui la constituent.» Ce que Peter Szendy se plaît à relever, c’est que les câbles du réseau internet suivent le plus souvent les axes de circulation et de communication qui les ont précédés. Il y aurait donc une forme de continuation d’un réseau à un autre, d’une infrastructure technologique à une autre.
Parallèlement, la circulation instantanée des images autour du globe ne concerne pas tout le monde, ni toutes les images. Certaines zones de conflit, comme la guerre du Tigré en Éthiopie ou les opérations au Cachemire en Inde, sont soumises à un embargo militaire sur les images. Et 11% de la population mondiale n’a pas accès à l’électricité. Pour illustrer ces temporalités hétérogènes de circulation, Peter Szendy cite une séquence du documentaire La Terre des âmes errantes de Rithy Panh, qui a suivi pendant trois mois l’excavation des tranchées destinées au premier câble à fibre optique du Cambodge, qui visait à relier l’Asie du Sud-Est à la Chine: «Un ingénieur montre un morceau de fibre optique à des ouvriers en leur expliquant de manière condescendante qu’il s’agit d’un câble ‹magique›, qu’ils peuvent grâce à lui envoyer instantanément des photos aux États-Unis. Ceux-ci, travaillant pieds nus pour un salaire misérable, lui répondent qu’ils n’ont pas d’électricité chez eux. N’est-il pas vertigineux de penser que ce même câble m’a permis de télécharger en quelques secondes un documentaire montrant les conditions inhumaines de sa lente pose par des personnes qui n’ont pas accès à sa vitesse?»
En plus de la quantité et de la vitesse de circulation, une autre transformation majeure récente est celle de la démocratisation de la production et de la mise en circulation des images, encore une fois due à la dissémination des téléphones intelligents et des réseaux sociaux. «Il y a peu, seuls les photographes professionnels et les agences possédaient un tel pouvoir sur la production et la circulation des images», précise Peter Szendy. On se situe maintenant loin de la Renaissance italienne, époque à laquelle il fallait être accepté dans la corporation des peintres pour posséder le droit de produire des images. «Les mécanismes de restriction et de contrôle du droit à produire des images sont présents dans de nombreuses sociétés», indique Emmanuel Alloa. Les nouvelles technologies nous auraient-elles affranchis de cela? Non, évidemment: «On peut dire que les conceptrices et concepteurs des algorithmes qui classent et hiérarchisent les images sont les nouveaux scribes 1Dans l’Égypte antique, les scribes étaient des fonctionnaires lettrés payés par l’État. Ils formaient une caste d’administrateurs, de comptables ou d’écrivains publics très respectée dans une société majoritairement analphabète. Cette position se léguait de père en fils, moyennant une éducation d’une douzaine d’années., dans le sens où une communauté restreinte de personnes contrôle, sinon la production, du moins la vitesse de circulation des images et leur visibilité. Dans une situation de tropplein d’images, le nerf de la guerre ne réside plus dans le contrôle de leur production, mais dans la captation de l’attention.»
Vers une iconomie globalisée
C’est justement à tous ces mécanismes de l’ombre derrière les images que s’intéresse l’ouvrage de Peter Szendy. Pour les désigner, il utilise le mot-valise d’«iconomie», contraction d’«icône» et d’«économie»: il s’agit, comme pour un supermarché, de saisir les flux, les circulations et tout le travail que la cliente ou le client ne voit pas derrière chaque aliment et son emballage. Sauf qu’ici, il s’agit d’images, mais l’analogie permet d’interroger pourquoi et comment telle image se retrouve propulsée dans les fils d’actualité «personnalisés» de chaque internaute pour capter son attention pendant souvent moins d’une seconde. «Cette logistique et ces travailleurs sont invisibles, comme dans les supermarchés, explique Peter Szendy. Il y a les infrastructures physiques, qui comprennent les réseaux mondiaux de câbles, mais également les quelques milliers de data centers 2Les data centers, ou centres de données – qui regroupent des installations informatiques destinées à stocker ou distribuer des données – consomment beaucoup d’énergie et contribuent aux rejets en CO2. En 2021, on peut estimer leur nombre dans le monde à 4’500. Ils sont répartis dans 122 pays sur tous les continents., les algorithmes et leurs concepteurs, les codecs, à savoir des logiciels qui assurent l’encodage et le décodage des images pour économiser l’espace, les fermes à clics…». Ces dernières produisent un travail à la chaîne de la visibilité avec des travailleuses et des travailleurs précaires, qui passent leurs journées à «liker» des visuels. L’iconomie globalisée se déploie donc sans que les personnes auxquelles les images sont destinées en soient conscientes. «Lorsqu’il ou elle ‹like› une photo sur les réseaux ou l’envoie à une correspondante ou un correspondant, l’internaute ignore souvent combien d’électricité il faut pour la faire voyager, pour réchauffer et refroidir les data centers, de même que le nombre de travailleurs précaires à l’oeuvre derrière ce fonctionnement», observe Peter Szendy.
Pour Emmanuel Alloa, le fonctionnement de l’iconomie globalisée mériterait d’être éclairci, car «nous allons vers une société de plus en plus visuelle. Nous utilisons toujours plus d’images pour communiquer, transmettre des savoirs. Mais cette transition n’a rien d’évident, car nous demeurons une société qui croit à l’autorité du texte écrit. Celui-ci continue de fonder nos instances politiques et notre système juridique.»


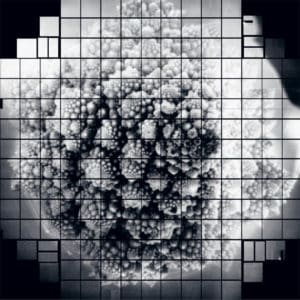

© Stephen Chung / Alamy Stock Photo, The Residents, Domaine Public, Slac National Accelerator Laboratory
Définitions
CODEC
Contraction de «coder-decoder», ce mot-valise désigne un logiciel qui convertit un flux vidéo ou audio dans un autre format en respectant une certaine norme, dans le but d’une transmission ou d’un stockage.
ICONOCLASME
Du grec eikonoklastês, briseur d’images, l’iconoclasme se réfère dans son sens premier à une doctrine de l’Empire byzantin qui a tenté de supprimer les icônes et d’interdire leur culte aux VIIIe et IXe siècles. Dans un sens plus récent, le terme désigne une personne ou un comportement d’hostilité vis-à-vis des normes, traditions ou croyances dominantes.
IMAGE
Du latin imago, qui signifie image, portrait, représentation ou effigie et désignait également les masques mortuaires, l’image peut être définie de multiples manières selon qu’elle soit mentale (psychique, sociale, historique…) ou artificielle (peinture, photographie, vidéo, numérique…).
PIXEL
Pixel provient de la contraction de «picture element». Il s’agit de l’unité de base permettant de mesurer la définition d’une image numérique. Les pixels sont de forme rectangulaire ou carrée et toujours associés à une couleur. Avec le Pixel Art, le pixel s’est mué en un mode de représentation du monde.
REPRÉSENTATION
Parmi les nombreuses définitions de ce terme également utilisé en droit, en psychologie ou en philosophie, on peut mentionner l’action de rendre sensible quelque chose au moyen d’une figure, d’un symbole ou d’un signe ou l’action de donner un spectacle devant un public.
SÉMIOLOGIE
Étude des signes, la sémiologie vient du grec sêmeion, signe, et lógos, parole, discours. Ce terme a été inventé par le médecin grec Hippocrate pour désigner l’étude des signes et des symptômes de la maladie. Plus récemment, la sémiologie est devenue une discipline qui étudie les systèmes de signes dans de nombreux domaines, comme la culture, la littérature ou la publicité.
«Il faut confronter des idées vagues avec des images claires.»
Jean-Luc Godard, La Chinoise, 1967


© Public Square Films, Domaine Public
Vidéos énergivores
Selon une étude menée en 2019 par le think tank The Shift Project, 4% du gaz à effet de serre mondial est produit par notre consommation numérique. Cette consommation énergétique invisible représente plus que celle de l’aviation civile. Elle pourrait doubler d’ici à 2025. La consommation de vidéos en ligne n’a cessé d’augmenter ces dernières années, or il s’agit de médias denses et particulièrement énergivores. Elles sont stockées dans des data centers avant d’être transférées sur nos smartphones ou nos ordinateurs via les réseaux. Ces processus nécessitent de l’électricité dont la production consomme des ressources et produit du CO2. Dix heures de vidéo en haute définition consomment plus de données que tous les articles en anglais de Wikipédia en format texte. En 2018, la consommation de vidéos en ligne a généré autant de gaz à effet de serre que la consommation annuelle d’un pays comme l’Espagne, soit 1% des émissions globales. Ce sont les plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon Prime qui représentent, avec 34%, la plus grosse part du trafic lié aux vidéos. En second lieu viennent les vidéos pornographiques, qui forment 27% de ce même trafic. Quant à la plateforme YouTube, elle représente 21% du trafic vidéo total.
Balayages oculaires des contenus
TEXTE | Geneviève Ruiz
INFOGRAPHIE | Bogsch & Bacco
La plupart des internautes ne lisent pas les contenus en ligne, ils les scannent. En quelques fractions de seconde et sans en avoir conscience, ils mobilisent l’un des six schémas de balayage oculaire ci-dessous. Ces résultats proviennent d’une série d’études réalisées durant treize ans par les spécialistes du Nielsen Norman Group sur plus de 500 participants. Ils soulignent que ces schémas n’ont pas changé depuis leur dernière étude datant d’il y a vingt ans, malgré les évolutions technologiques.


